
Le terme « offre complète » occupe une place centrale dans les discours commerciaux des prestataires d’infogérance. Pourtant, derrière cette promesse rassurante se cache une réalité bien plus nuancée que ne le laissent entendre les plaquettes marketing. Entre le périmètre technique théoriquement couvert et les engagements contractuels effectifs, un écart substantiel demeure systématiquement occulté.
Cette zone grise contractuelle constitue précisément le point de départ d’une démarche éclairée. Avant de découvrir la société d’infogérance VerseIT, comprendre la mécanique réelle d’une offre d’infogérance nécessite de déconstruire le concept marketing de « complète ». Le marché français illustre cette dynamique : avec 13 milliards d’euros représentant la valeur du marché en 2020, l’infogérance s’impose comme une réponse structurante aux enjeux de transformation numérique.
Pourtant, cette croissance masque une réalité fondamentale : déléguer ne signifie jamais abdiquer. Chaque entreprise conserve des responsabilités incompressibles, des pré-requis organisationnels conditionnent le succès du partenariat, et certains contextes rendent l’approche « tout-en-un » contre-productive. L’objectif de cet article consiste à cartographier ces responsabilités cachées et à bâtir un cadre d’évaluation adapté à votre contexte spécifique.
L’offre d’infogérance décryptée en 5 points
- Le périmètre contractuel garanti diffère souvent du périmètre technique couvert par les outils de supervision
- Les responsabilités stratégiques (arbitrages budgétaires, validation des roadmaps) restent systématiquement à la charge du client
- Un niveau minimal de documentation et de maturité processuelle conditionne la réussite de l’infogérance
- L’évaluation pertinente repose sur une pondération personnalisée selon vos fonctions métier critiques
- Certains contextes (infrastructures multi-cloud, forte expertise interne) rendent l’offre complète inadaptée
Décoder le périmètre réel derrière l’étiquette ‘offre complète’
La notion de périmètre constitue le premier terrain d’ambiguïté contractuelle. Les prestataires présentent leurs offres selon une logique de composantes techniques : supervision des infrastructures, maintenance préventive et corrective, support utilisateurs, gestion de la sécurité, sauvegarde et plan de reprise. Cette énumération crée l’illusion d’une couverture exhaustive.
La réalité contractuelle introduit une distinction rarement explicitée. Le périmètre technique couvert désigne l’ensemble des éléments surveillés ou maintenus par les outils du prestataire. Le périmètre contractuel garanti définit les services dont la défaillance déclenche une compensation ou l’application de pénalités. Ces deux périmètres ne se superposent jamais parfaitement.
Les données du marché confirment cette fragmentation des services. L’infogérance se déploie selon différentes modalités : services d’applications pour 59% des utilisations, gestion de l’infrastructure informatique pour 49%, solutions cloud pour 38%, et services réseaux pour 33% selon une étude menée en 2018. Cette répartition révèle que peu d’entreprises souscrivent réellement à une couverture uniforme de tous les domaines.
| Type de service | Taux d’utilisation | Évolution 2023-2024 |
|---|---|---|
| Services d’applications | 59% | +6% (SaaS) |
| Infrastructure IT | 49% | Stable |
| Cloud Computing | 38% | +20,4% |
| Services réseaux | 33% | N/A |
| Sécurité | N/A | +10% |
Au-delà de cette fragmentation fonctionnelle, les plafonds quantitatifs constituent la seconde dimension masquée du périmètre. Un service « inclus » peut s’accompagner de limites volumétriques : nombre maximum de tickets de support par mois, heures d’intervention on-site plafonnées, capacité de stockage des sauvegardes limitée, ou nombre d’actifs supervisés défini contractuellement. Le dépassement de ces seuils bascule vers une facturation additionnelle rarement anticipée.
Les trois niveaux d’engagement constituent la troisième grille de lecture indispensable. Une obligation de moyens engage le prestataire à déployer les ressources et processus nécessaires, sans garantir le résultat. Une obligation de résultat le rend responsable de l’atteinte d’objectifs mesurables, généralement définis par les SLA. Entre ces deux extrêmes, la distinction entre couverture passive (détection d’incidents) et proactive (prévention par analyse des tendances) détermine la valeur réelle du service.
Les exclusions contractuelles, reléguées dans les annexes, complètent ce tableau. Les applications métier spécifiques développées en interne échappent fréquemment au périmètre standard. Les environnements non-standards, utilisant des configurations ou des versions logicielles particulières, nécessitent souvent une prestation sur-mesure. Les interventions hors périmètre géographique ou en dehors des plages horaires contractualisées génèrent des coûts supplémentaires rarement anticipés lors de la signature.
Cartographier les responsabilités qui restent toujours à votre charge
La promesse commerciale d’une délégation totale occulte systématiquement une dimension structurelle de l’infogérance : certaines responsabilités demeurent incompressibles côté client. Cette gouvernance partagée ne résulte pas d’une limitation du prestataire, mais de la nature même de la relation contractuelle. Identifier précisément ces responsabilités résiduelles permet d’anticiper les ressources internes à conserver et d’éviter le syndrome de la « boîte noire ».
Les décisions stratégiques constituent le premier bloc de responsabilités non déléguables. Les arbitrages budgétaires entre investissement et fonctionnement, la validation des roadmaps techniques alignées sur les orientations métier, le choix des priorités d’évolution face à des ressources limitées, et la gestion des obsolescences technologiques relèvent de choix stratégiques que seule l’entreprise cliente peut assumer. Le prestataire apporte son expertise technique, mais la décision finale appartient au donneur d’ordre.
Responsabilités incompressibles côté client
- Maintenir la validation des changements et arbitrages budgétaires stratégiques
- Fournir la documentation applicative et cartographie des criticités métier
- Assurer la gouvernance avec comité de pilotage et référent technique interne
- Gérer les contacts avec les éditeurs tiers et valider les roadmaps techniques
- Contrôler la qualité de service via les tableaux de bord et indicateurs fournis
La matrice RACI formalise cette répartition des rôles. Pour chaque grande famille d’activité, elle définit qui est Responsable de l’exécution, qui est Accountable et porte la responsabilité finale, qui doit être Consulté, et qui doit être Informé. Dans une infogérance complète, le prestataire assume généralement la responsabilité opérationnelle des incidents et de la maintenance, tandis que le client conserve l’accountability sur les décisions stratégiques et la validation des changements.

Cette répartition reflète une tendance de fond du marché. Les entreprises reconnaissent désormais que 47% d’entre elles cherchent à améliorer la qualité via l’infogérance tout en conservant le contrôle stratégique. Cette approche équilibrée permet d’éviter la dépendance totale tout en bénéficiant de l’expertise externe.
Les inputs documentaires constituent le deuxième ensemble de responsabilités client. Le prestataire ne peut opérer efficacement sans disposer de la documentation applicative détaillant les spécificités fonctionnelles, de la cartographie des criticités métier hiérarchisant les priorités d’intervention, du calendrier des pics d’activité anticipant les besoins en capacité, et des contacts des éditeurs tiers pour la résolution d’incidents complexes. Ces informations relèvent de la connaissance métier que seul le client détient.
| Activité | Client | Prestataire |
|---|---|---|
| Décisions stratégiques SI | Responsable | Consulté |
| Gestion des incidents | Informé | Responsable |
| Validation des changements | Accountable | Responsable |
| Documentation métier | Responsable | Informé |
| Maintenance infrastructure | Informé | Responsable |
La gouvernance opérationnelle représente le troisième pilier des responsabilités client. Le comité de pilotage régulier assure le suivi de la qualité de service et l’ajustement du contrat aux évolutions métier. Un référent technique interne capable de dialoguer avec le prestataire, de comprendre les reportings techniques, et de traduire les enjeux métier en exigences IT demeure indispensable. La validation des livrables et le contrôle de la qualité via les tableaux de bord complètent ce dispositif de gouvernance partagée.
Identifier vos pré-requis organisationnels avant toute souscription
Le discours commercial des prestataires suggère fréquemment qu’une offre d’infogérance peut se déployer sur n’importe quelle infrastructure, quel que soit son état initial. Cette posture « prêt à l’emploi » occulte une réalité opérationnelle : certains pré-requis côté client conditionnent directement le succès du partenariat. Une infrastructure trop dégradée ou insuffisamment documentée peut nécessiter une phase préalable de remise à niveau, dont le coût et la durée dépassent souvent les prévisions initiales.
Le niveau de documentation constitue le premier critère de « mise en infogérabilité ». L’inventaire complet des actifs, la cartographie réseau précise, la matrice des flux applicatifs, et les procédures d’exploitation existantes forment le socle informationnel minimal. Sans cette base documentaire, la phase d’audit initial explose en durée et en coût, le prestataire devant reconstituer de zéro une connaissance que l’entreprise aurait dû capitaliser.
Des cas concrets illustrent l’importance de cette préparation organisationnelle. La transformation numérique réussie nécessite un partenariat de long terme fondé sur une infrastructure fiable et une communication fluide entre les équipes.
Transformation avec un partenaire d’infogérance de confiance
La Maison Convertible collabore avec son prestataire d’infogérance depuis 2018 pour la gestion et la sécurisation du système d’information de 140 collaborateurs. Cette collaboration de plus de 10 ans repose sur une équipe réactive et compétente, permettant de travailler sereinement grâce à une infrastructure IT fiable et sécurisée. Cette stabilité illustre l’importance d’une base organisationnelle solide avant l’engagement.
La maturité processuelle représente le deuxième pré-requis fondamental. L’existence de processus formalisés de gestion des changements évite les interventions anarchiques générant des incidents en cascade. Une procédure claire de validation des interventions, avec des circuits de décision identifiés et des niveaux d’approbation définis, prévient les blocages opérationnels récurrents. Sans cette discipline processuelle minimale, même un prestataire compétent se heurte à l’impossibilité d’opérer efficacement.
L’état technique de l’infrastructure agit comme troisième facteur qualifiant ou disqualifiant. Les environnements fonctionnant avec des versions logicielles hors support éditeur exposent le prestataire à des risques qu’il ne peut juridiquement assumer. Les configurations non-standard, fruit d’années d’adaptations empiriques, génèrent des coûts de prise en charge prohibitifs. Une dette technique massive, accumulée faute d’investissements réguliers, nécessite d’abord un plan de remédiation avant que l’infogérance ne devienne viable économiquement.
| Critère de maturité | Niveau minimal requis | Impact si absent |
|---|---|---|
| Documentation technique | 70% documenté | +30% coût audit initial |
| Processus ITIL | 3 processus clés | Blocages opérationnels |
| Support éditeur actif | 100% des systèmes critiques | Refus de prise en charge |
| Budget IT défini | Prévisionnel sur 12 mois | Impossibilité de contractualiser |
Les ressources humaines internes constituent le quatrième pilier de cette préparation. Au minimum, un référent technique capable de dialoguer d’égal à égal avec le prestataire, de comprendre les reportings techniques sans dépendre d’interprétations externes, et de piloter la relation contractuelle en assurant le suivi des SLA demeure indispensable. L’infogérance ne supprime pas le besoin de compétences internes, elle en déplace le centre de gravité de l’opérationnel vers le pilotage stratégique.
Construire votre grille d’évaluation par composante métier critique
Les checklists génériques de critères d’évaluation saturent les guides d’achat. Elles proposent des barèmes standardisés : disponibilité minimum de 99,9%, temps de réponse inférieur à 15 minutes, couverture 24/7, certifications ISO obligatoires. Cette approche universelle ignore une réalité fondamentale : la criticité des services IT varie radicalement selon les secteurs et les modèles d’activité.
La messagerie constitue un actif vital pour un cabinet juridique traitant des dossiers sensibles avec des délais contraints. Un RTO de 4 heures sur la messagerie serait inacceptable. À l’inverse, pour une entreprise industrielle dont le cœur d’activité repose sur des équipements de production pilotés par des systèmes SCADA, la criticité maximale se concentre sur les infrastructures de supervision et de contrôle. La messagerie, bien qu’utile, tolère une indisponibilité de plusieurs heures sans impact majeur sur la production.
Les DSI savent que les projets d’IA d’aujourd’hui joueront un rôle déterminant avant que l’IA générative ne soit opérationnelle
– John-David Lovelock, Gartner
Cette prise de conscience de la singularité des besoins s’inscrit dans un contexte de forte évolution du marché IT. Les projections anticipent 8,38% de croissance annuelle du marché des services IT jusqu’en 2029, portée notamment par l’intégration de technologies émergentes. Cette dynamique renforce la nécessité d’une évaluation personnalisée plutôt que standardisée, notamment pour choisir un prestataire d’infogérance de confiance.
La première étape de construction d’une grille personnalisée consiste à cartographier vos fonctions métier critiques et leur dépendance IT. Identifiez les 5 à 7 processus métier dont l’arrêt bloque totalement l’activité ou génère des pertes financières immédiates. Pour chacun, déduisez les services IT sous-jacents : application spécifique, connectivité réseau, système de stockage, service d’authentification. Cette cartographie révèle vos priorités réelles, souvent différentes des standards du marché.
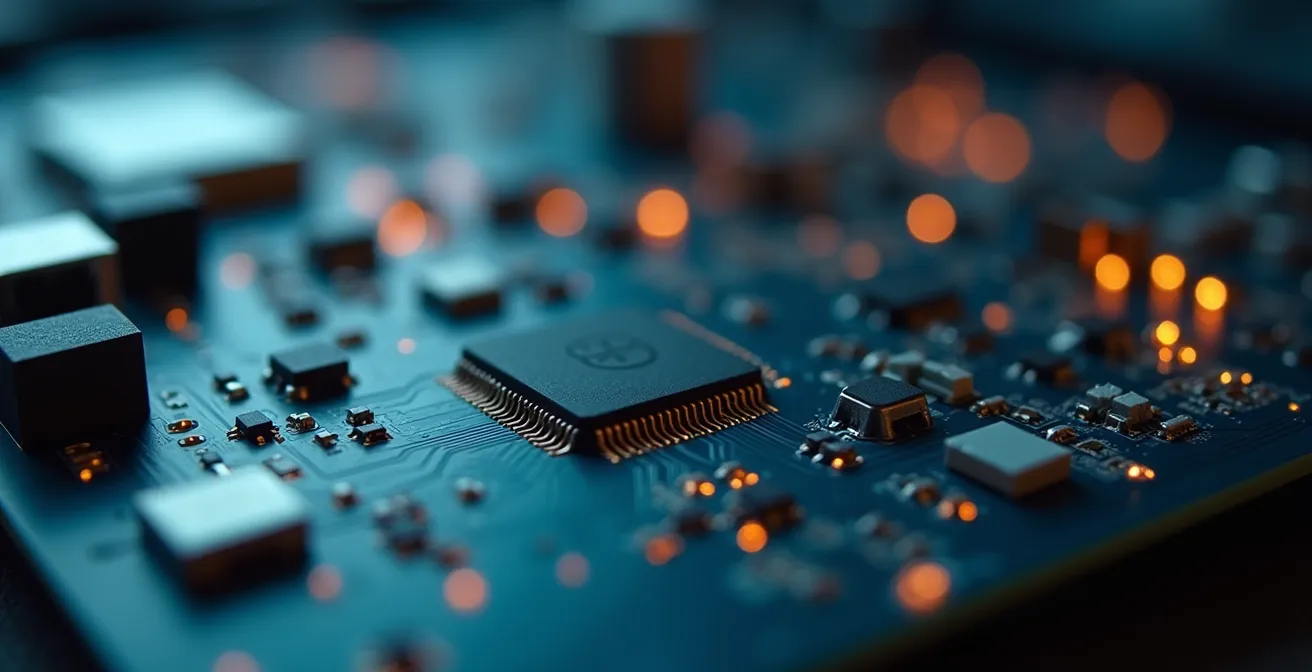
La définition de critères de couverture pondérés constitue la deuxième étape. Pour chaque fonction critique identifiée, définissez un RTO (Recovery Time Objective) et un RPO (Recovery Point Objective) acceptables. Spécifiez les plages horaires de support nécessaires : un site de e-commerce requiert une couverture 24/7, tandis qu’une PME en B2B peut tolérer un support limité aux heures ouvrées avec astreinte. Le niveau de proactivité attendu, la capacité d’évolution pour accompagner la croissance, et les exigences de conformité réglementaire complètent cette pondération personnalisée.
Méthodologie d’évaluation personnalisée
- Identifier vos 5-7 processus métier dont l’arrêt bloque l’activité
- Définir les RTO/RPO spécifiques pour chaque fonction critique
- Pondérer les critères selon votre contexte (disponibilité, performance, évolutivité)
- Scorer chaque brique de l’offre selon vos critères pondérés
- Simuler des scénarios de défaillance pour valider la cohérence
La construction d’une matrice d’évaluation composante par composante transforme ces critères en outil opérationnel. Pour chaque brique de l’offre (supervision, sauvegarde, support, sécurité), attribuez un score selon vos critères pondérés. Un cabinet médical pondérera fortement la conformité RGPD et HDS sur le volet sécurité et sauvegarde. Une start-up technologique privilégiera l’agilité et la capacité d’évolution rapide. Cette matrice personnalisée remplace avantageusement les grilles universelles inadaptées à votre contexte.
La simulation de scénarios de défaillance constitue l’ultime validation de cohérence. Projetez-vous dans des situations concrètes : incident majeur sur votre application critique un samedi soir, cyberattaque par ransomware chiffrant vos données, perte complète d’un datacenter. Pour chaque scénario, vérifiez que l’offre évaluée couvre réellement le cas : le support est-il disponible aux horaires de l’incident, les sauvegardes permettent-elles une restauration dans les délais RTO/RPO définis, le plan de reprise d’activité inclut-il des infrastructures de secours dimensionnées correctement. Ces simulations révèlent les incohérences entre promesses contractuelles et réalité opérationnelle.
À retenir
- Distinguez systématiquement périmètre technique couvert et périmètre contractuel garanti pour éviter les mauvaises surprises
- Anticipez les responsabilités incompressibles (arbitrages, documentation métier, gouvernance) en conservant les ressources internes nécessaires
- Évaluez votre maturité IT avant toute souscription : documentation, processus, état technique conditionnent le succès
- Construisez une grille d’évaluation pondérée selon vos fonctions métier critiques plutôt que d’appliquer des standards génériques
- Vérifiez votre contexte organisationnel : certaines situations rendent l’offre complète contre-productive face à des solutions modulaires
Reconnaître les contextes où l’offre complète devient inadaptée
Le discours dominant du marché présente l’offre d’infogérance complète comme universellement souhaitable. Cette posture promotionnelle univoque occulte une réalité stratégique : certains contextes organisationnels ou techniques rendent cette approche globalisante moins performante qu’une solution modulaire ou hybride. Identifier ces situations atypiques protège contre une souscription inadaptée générant plus de friction que de valeur.
Les infrastructures hybrides multi-cloud complexes constituent le premier contexte de contre-indication. Lorsqu’une entreprise opère simultanément des workloads sur AWS, Azure, un cloud privé VMware, et des serveurs physiques on-premise, la diversité technologique dépasse souvent la capacité de maîtrise d’un prestataire unique. Un acteur capable d’excellence sur l’ensemble de cette stack hétérogène demeure exceptionnel. Une orchestration de spécialistes, chacun expert sur sa technologie, génère fréquemment de meilleurs résultats qu’un généraliste en difficulté sur certaines composantes.
Le contexte économique a d’ailleurs démontré les limites de certains modèles. Le marché de l’externalisation a connu des ajustements significatifs : au premier trimestre 2020, la valeur des contrats a progressé mais moins qu’anticipé sans la crise sanitaire, suggérant une baisse d’environ 7% de l’externalisation en raison de la pandémie. Cette fragilité conjoncturelle rappelle qu’une dépendance totale expose à des risques systémiques.
| Contexte d’entreprise | Infogérance complète adaptée | Solution alternative recommandée |
|---|---|---|
| Infrastructure multi-cloud complexe | Non | Orchestration multi-prestataires |
| Secteur hautement réglementé | Partielle | Modèle hybride avec rétention interne |
| Forte croissance/pivots fréquents | Non | Services modulaires flexibles |
| PME avec SI standard | Oui | – |
| Expertise IT interne forte | Non | Assistance ciblée uniquement |
Les environnements hautement réglementés avec contraintes de souveraineté représentent le deuxième cas limite. Les secteurs bancaire, santé, défense, ou énergie font face à des exigences strictes de traçabilité, d’isolement des données, et de contrôle d’accès. Ces obligations légales rendent parfois préférable un modèle avec forte rétention interne des compétences, l’infogérance se limitant aux couches non sensibles de l’infrastructure. Le risque de non-conformité, aux conséquences juridiques et réputationnelles majeures, justifie cette approche prudente.
Les entreprises en forte croissance ou pratiquant des pivots stratégiques fréquents constituent le troisième profil atypique. Lorsque le rythme d’évolution de l’infrastructure est très élevé, avec des modifications architecturales régulières, des migrations technologiques rapides, ou des absorptions d’entités externes, les engagements rigides d’une offre complète deviennent un carcan. La renégociation permanente du périmètre et des conditions contractuelles génère des coûts de transaction prohibitifs. Des services modulaires à la demande, facturés à l’usage, préservent l’agilité nécessaire à ces contextes mouvants.
Le secteur IT témoigne de cette complexité croissante. La convergence technologique transforme profondément les besoins : l’intelligence artificielle, l’internet des objets, et la blockchain s’entremêlent désormais. Cette intégration nécessite des compétences transversales. Parallèlement, la multiplication des cybermenaces propulse la cybersécurité au rang de priorité absolue, les entreprises recherchant des experts spécialisés pour leur protection. Cette demande en professionnels de sécurité connaît une croissance fulgurante, illustrant la nécessité d’expertises pointues plutôt que généralistes.
Les organisations dotées d’une expertise IT interne forte représentent le quatrième et dernier profil. Lorsque les équipes internes possèdent des compétences techniques solides et souhaitent conserver la main sur les décisions opérationnelles quotidiennes, une offre complète crée plus de friction qu’elle n’apporte de valeur. Le prestataire devient un intermédiaire ralentissant la réactivité. Un modèle d’assistance ciblée, où le prestataire intervient uniquement sur des expertises spécifiques absentes en interne ou lors de pics de charge, respecte mieux l’autonomie de ces équipes compétentes. Pour ces organisations, découvrez les bénéfices de l’infogérance adaptée à vos besoins spécifiques devient une démarche de complémentation plutôt que de substitution.
Ces quatre contextes ne constituent pas des contre-indications absolues, mais des signaux d’alerte invitant à questionner le dogme de l’offre complète. Ils rappellent qu’une approche sur-mesure, combinant infogérance sur certains périmètres et rétention interne sur d’autres, génère parfois de meilleurs résultats qu’une délégation totale standardisée. La lucidité sur votre situation spécifique prime sur l’adhésion aux discours marketing dominants.
Questions fréquentes sur l’infogérance informatique
Quelles ressources humaines doivent rester en interne ?
Au minimum un référent technique capable de dialoguer avec le prestataire, comprendre les reportings et piloter la relation contractuelle est indispensable.
Comment évaluer la maturité de mon infrastructure ?
Vérifiez l’existence de processus de gestion des changements, des circuits de décision identifiés et l’absence d’environnements hors support éditeur.
Quelle est la différence entre périmètre technique et périmètre contractuel ?
Le périmètre technique désigne les éléments surveillés par les outils de supervision, tandis que le périmètre contractuel définit les services dont la défaillance déclenche compensation ou pénalités. Ces deux périmètres ne se superposent jamais parfaitement.
Dans quels cas une offre modulaire est-elle préférable à une offre complète ?
Les infrastructures multi-cloud complexes, les secteurs hautement réglementés, les entreprises en forte croissance avec pivots fréquents, et les organisations dotées d’une expertise IT interne forte bénéficient davantage de solutions modulaires ou hybrides permettant une adaptation précise aux besoins.